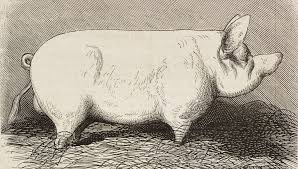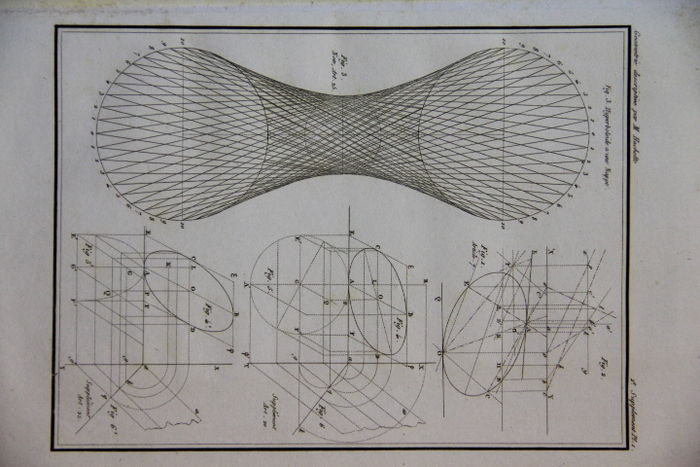Intervention à Polytechnique à l’initiative conjointe de X-Alternative et des conférences Coriolis
Chères et chers camarades
Partout où vous portent vos pas dans cette école vous rencontrez son histoire pour peu que vous vouliez bien vous y attarder. Un des pères fondateurs, le grand mathématicien Gaspard Monge, qui versa à la Kès des élèves le montant de son salaire de professeur le jour ou Napoléon décida de ne plus verser la solde des élèves un peu trop récalcitrants à son goût, était connu pour être le seul à oser dire son fait à l’empereur. Il était connu aussi pour avoir, comme ministre de la marine, mis en place les fontes de canons pour défendre le territoire agressé par les coalitions contre-révolutionnaires. Avec un autre père fondateur, Claude Berthollet, c’est l’arsenal des poudres qu’il réformait.
Plus près de nous, Louis Armand, après avoir inventé le traitement anti- corrosion des machines à vapeur, devint un grand résistant pendant la seconde guerre mondiale, dirigea la SNCF et mena d’une main de maître le développement du TGV, créa Euratom, mis en place les premiers accords franco- allemands permettant aux trains de marchandises de ne pas revenir vides au retour d’un voyage entre la France et l’Allemagne. Il est intéressant de savoir qu’il donna pendant plus de 20 ans un cours à l’ENA sur « sciences et technologies de la France industrielle de sorte que notre haute administration, au temps où il fallait reconstruire le pays, était au fait de ce qu’il fallait reconstruire et pourquoi.
Sous ces figures tutélaires, la mission de l’X au-delà de sa fameuse devise « pour la patrie, les sciences, la gloire », reste :
Fidèle à son histoire et à sa tradition, l’École forme de futurs responsables de haut niveau, à forte culture scientifique, voués à jouer un rôle moteur dans le progrès de la société par leurs fonctions dans les entreprises, les services de l’État et la recherche.
Je ne pense pas qu’il y ait lieu de changer cette mission, mais il est urgent de rappeler ce qu’elle veut dire. Vous êtes héritiers d’une longue tradition, en particulier d’une longue tradition de serviteurs de l’État. Les Louis Armand, Georges Besse, Francis Mer, André Giraud, Robert Dautray sont autant d’exemples de grands serviteurs de l’état. Et les grands acteurs de la science ne se limitent pas aux figures emblématiques de Poincaré, Arago ou Gay-Lussac.
Plus près de nous le père fondateur de la physique des solides et de la science des matériaux en France, Jacques Friedel que j’ai eu l’honneur de connaître, était non seulement un immense scientifique, mais aussi un serviteur de l’État, tout en étant professeur des universités. Un rapport sur la recherche en France en 1980 n’a pas pris une ride et si on avait suivi ses recommandations, on ne serait pas face à un « canard sans tête » qui pense avoir une politique parce qu’il « surfe » sur quelques « buzzwords ». Le rapport « Friedel-Lecomte » sur l’enseignement à l’école polytechnique, reprenant le rapport Arago-Gay Lussac, et les injonctions de Louis Armand, rappelle invariablement de ce que l’école polytechnique doit être et l’on rêve de ces époques ou les rapports étaient sortis de telles plumes…et étaient lus, voire écoutés, et en tout cas offraient une réflexion d’une autre qualité de la « fixette » sur le classement de Shangai ! Jacques Friedel a présidé aussi « l’Observatoire de la lecture », non pas parce qu’il savait tout de la pédagogie, mais parce qu’il pensait à juste titre que l’enseignement dans les petites classes de la lecture était une brique essentielle pour la formation du citoyen. Quand Jacques Friedel prenait la parole à l’académie des sciences, on aurait entendu une araignée marcher tant le respect était grand pour ce Monsieur qui savait allier la qualité scientifique, la rigueur morale et le service de l’État.
Je ne vais pas vous imposer une « laudatio tempora acti », car c’est à de jeunes polytechniciens et polytechniciennes que je m’adresse, à vous qui allez devoir participer à reconstruire un pays qui, à force de négligences et d’incompétences où notre école a malheureusement joué sa part peu glorieuse, ne sera bientôt plus que ruines fumantes. La situation que se profile devant vous, sur fond de crise climatique, de crise énergétique, de désindustrialisation massive du pays, de crise sociale, de crise internationale, n’est guère plus rassurante que celle qu’ont prise en mains nos grands anciens au sortir de la guerre. Mais nous devons nous montrer dignes de ce qu’ils nous avaient laissé en héritage.
Pour terminer ce propos liminaire, je voudrais vous dire ce que le général Saulnier disait aux polytechniciens de ma promotion :
« la proportion des cons est la même partout, mais ils sont d’autant plus dangereux qu’ils sont plus soigneusement choisis ».
En tant que polytechniciens, vous avez une dette envers l’état, de par la qualité de l’enseignement que vous avez reçu, de par les conditions exceptionnelles qui vous ont été données, sur évaluation votre mérite, pour le recevoir. Être polytechnicien oblige. La dette au sens où je l’entends n’est pas tellement financière…Elle est morale, elle est de celles qui vous attendent au soir de votre vie pour peu que vous vous regardiez sans complaisance. Une des façons de la payer est le service de l’État, et dans les multiples façons de servir l’État, le travail de conseiller sur les dossiers techniques importants, qui est le rôle des grands corps techniques de l’État, est une œuvre « souterraine » qui peut être importante tout comme elle peut être vaine, tout dépend de la qualité du conseil et de la volonté du décideur d’être informé, voire de sa capacité à comprendre qu’il est nécessaire de l’être et à réaliser que le discours ne peut pas indéfiniment se substituer à l’action. Georges Canguilhem le disait avec justesse : « Ceux qui ne font pas l’effort nécessaire pour comprendre ne méritent pas d’être éclairés ». Mais cela ne dispense pas pour autant le conseiller de faire son devoir.
Je voudrais vous faire part ce jour de mon expérience de « conseiller » dans un poste assez particulier, celui de Haut-Commissaire à l’énergie atomique. Ce poste singulier, crée en même temps que le CEA par le général De Gaulle, est au sein du CEA (pour en connaître tous les détours et savoir la science qui s’y fait), mais n’est pas dans la chaîne hiérarchique du CEA : il n’est pas sous les ordres de l’administrateur général puisqu’il doit pouvoir dire en toute indépendance à l’exécutif ce qu’il pense devoir être fait pour que les missions du CEA, civiles et militaires, définies par décret de la république, soient convenablement remplies. Inutile de vous dire que la mission est passionnante, qu’elle n’est pas de tout repos, et que la mener à bien suppose d’une part que l’exécutif comprenne la nécessité d’une expertise scientifique sur ces questions, et d’autre part que l’administrateur général comprenne la valeur d’un conseiller indépendant sans pouvoir décisionnel, et n’attende pas à ce poste une plante verte à envoyer explorer les mines de petits fours dans les ministères. Cela suppose aussi que le Haut-Commissaire ne prétende pas se substituer à l’organe de décision, qu’il ne cède pas à la tentation de donner par voie de presse à ses avis un poids excédant celui de la compétence scientifique des collèges d’experts qu’il anime, qu’il fasse comprendre au gouvernement que la réserve absolue qu’il s’impose au cours de son mandat se paye d’une franchise non moins absolue dans les avis qu’il leur réserve.
J’ai occupé cette fonction pendant six ans, avec deux administrateurs généraux de grande facture, Bernard Bigot et Daniel Verwaerde. Quand j’ai considéré que je ne pouvais plus remplir cette fonction avec la liberté qu’elle exige, je suis parti.
La situation que vous voyez dans le domaine de l’énergie, qui est, faut-il le rappeler, le sang de notre économie, prouve à l’évidence que les bonnes décisions n’ont pas été prises. Nous allons payer au prix fort quinze ans de politiques ineptes. Aucun des avertissements lancés n’a jamais été écouté, on peut se demander même s’ils ont été entendus. Et pourtant, il ne manquait pas de polytechniciens dans des couloirs des ministères pour les entendre. On peut se tirer d’affaire comme souvent par une boutade, revenant à la définition que donnait J.Schumpeter : « les mauvais politiciens sont semblables aux mauvais cavaliers qui sont tellement soucieux de se tenir en selle qu’ils ne se préoccupent plus de la direction qu’ils prennent ».
Mais quand on erre avec une telle constance, qu’on dénie ensuite à ce point toute forme de responsabilité dans les décisions prises et leurs conséquences, et cela dans des domaines aussi variés que l’énergie, la métallurgie, l’agroalimentaire, la santé, la microélectronique, il faut bien admettre que ce ne peut être une question d’individualités, mais que l’ensemble des processus de conseil scientifique auprès de l’exécutif d’un état historiquement colbertien, a failli.
L’expérience dont je vais vous faire part m’a conduit à rencontrer de nombreuses fois ces « conseillers de ministère », souvent des « chers camarades » mais pas toujours, qui, en principe, doivent assurer « l’adaptation d’impédance » entre des expertises très techniques telles que celle que j’avais à mener, et l’exécutif qui avait in fine, légitimité à prendre les décisions. Comme nombre d’entre vous, en tant que membres des grands corps techniques de l’état, peuvent avoir à jouer ce rôle dans les années à venir, il me semblait important de partager avec vous mon retour d’expérience.
Car il ne faut pas se cacher que la responsabilité du conseiller technique auprès de l’exécutif est grande. La classe politique est essentiellement technologiquement et scientifiquement décérébrée. C’est un fait. La confusion entre le discours et l’action, le renoncement progressif et aujourd’hui revendiqué à la nécessité de cohérence dans le discours, n’aident pas. Mais si le sens du bien commun, et une vision politique à long terme sont indispensables dans les questions qui nous préoccupent, la connaissance scientifique détaillée des dossiers, au niveau du décideur politique, n’est pas un prérequis pour le décideur : le programme électronucléaire a été décidé par un agrégé de grammaire et un colonel de la légion étrangère, Georges Pompidou et Pierre Messmer. Le plus grand patron que EDF ait jamais eu, était un mathématicien économiste, Marcel Boiteux. Ils avaient auprès d’eux des Bernard Esambert, des Robert Guillaumat, des Jean Claude Leny et des Michel Hug pour les conseiller. Je n’aurai pas la cruauté de pousser plus avant le parallèle avec la situation actuelle.
Pour comprendre le rôle de l’expertise scientifique dans un pays comme le nôtre où l’État est omniprésent, il faut avoir conscience de la chaîne d’information qui mène à la décision : l’exécutif, les conseillers proches de l’exécutif, « traducteurs du technique » auprès du prince, et les producteurs d’avis scientifiques et techniques. Viennent de surajouter à cela les multiples comités Théodule, Haut Conseil aux diverses choses, missions en tout genre, conventions de tout poil, et autre conseils économique et sociaux et environnementaux, qui ont au mieux une fonction décorative, au pire une fonction de diversion, et dans tous les cas un objectif de communication plus que d’analyse.
Les niveaux de compétence scientifique et technique dans cette chaîne d’information, sont extrêmement divers : quasi nulle au niveau de l’exécutif, aléatoire au niveau des conseillers, d’autant plus solide au niveau de « producteurs d’avis » qu’ils mettent en œuvre des expertises collectives, comme c’est le cas des académies des sciences, des académies de technologies, du Haut-Commissaire à l’énergie atomique quand il fait correctement son travail en mobilisant des collèges d’experts.
Les talents de communicants sont en général en raison inverse du contenu à communiquer : en corollaire, on peut deviner que le niveau de l’exécutif communique beaucoup, et que les producteurs d’expertise ont en général des talents de communiquant médiocres. Les conseillers auprès de l’exécutif, postes par lesquels vous êtes susceptibles de passer, sont donc un chaînon essentiel dans la prise de décision scientifiquement instruite, et donc dans la construction d’une politique qui soit à la fois légitime et rationnelle.
Quelle est la typologie des « conseillers techniques » dans les ministères, qu’ils soient rattachés à un ministre ou à un de ses services, la Direction générale de l’énergie et du climat par exemple. Ils sont comme les champignons, il y a les « comestibles », les « vénéneux », et les pires d’entre eux, les « toxiques » qui ont l’apparence du comestible.
Parmi nos chers camarades, il y a heureusement des « comestibles », qui font honnêtement leur travail d’analyse scientifique et technique. Il y a aussi dans cette catégorie certains Énarques « bien câblés » qui, s’ils n’ont pas de compétence scientifique particulière, ont une capacité à raisonner et à interroger qui forcent l’expert à cesser de jargonner et à se rendre accessible. Les meilleurs conseillers que j’ai eu à pratiquer dans les ministères sont de cette catégorie, palliant le manque de capacité à communiquer des sources d’expertise et l’absence totale de culture scientifique technique et industrielle du sommet de l’exécutif. Ces conseillers là nous rappellent opportunément que si la science est un métier, la raison est un bien commun, et que le sens de l’état est une vertu indispensable chez un conseiller.
Je ne doute pas que notre école ne puisse fournir de bons conseillers « comestibles ». Pour peu que le doctrinaire et l’idéologique prenne le pas sur le scientifique, elle peut aussi fournir des conseillers « vénéneux », mais on n’y peut rien, c’est dans la nature humaine. Il m’importe en vous parlant de vous signaler le risque plus sournois du conseiller toxique qui a l’air comestible.
Si vous me permettez une digression, il y a une tradition au Canada qui est celle de « l’anneau d’acier ». Aux ingénieurs à qui on donne leur diplôme, on donne en même temps un anneau d’acier qu’ils porteront au doigt toute leur vie d’ingénieur, et qui est forgé à partir de l’acier dont on fit un pont qui s’est effondré. On rappelle ainsi aux nouveaux ingénieurs la responsabilité que leur donne auprès de leurs concitoyens une compétence qui leur est reconnue. C’est plus discret que le bicorne, on le met moins facilement au placard, mais j’aimerais qu’un tel symbole soit remis aux polytechniciens diplômés pour leur rappeler que quand ils prennent une décision techniquement absurde, ils doivent en être tenus pour responsables et ne peuvent pas s’en tirer avec des effets de manche ou des coups de menton, ou un piteux « j’ai obéi à mon ministre ».
Dans un milieu, celui de la décision politique, qui est en déshérence quasi-totale en ce qui concerne la culture scientifique, technique et industrielle, le conseiller technique, qui arrive paré de son diplôme, surtout s’il est aussi prestigieux que le diplôme de polytechnicien, et a fortiori de « corpsard » des mines ou des ponts, apparaît immédiatement comme un champignon comestible ce qu’il peut être en effet. Mais il peut facilement faire illusion et par voie de conséquence, se muer en « conseiller toxique ». Le vice systémique à la racine du mal qui nous ronge est l’immaturité technique du décideur politique (quand ce n’est pas simplement le manque de sens de l’état…) couplé à une structure d’écran de toute information technique par les conseillers proches.
La France a ceci de singulier que la haute administration et l’industrie sont étroitement imbriqués, par les corps techniques de l’État, par les méandres de l’ENA. Cette intrication fait que, à défaut d’avoir une politique industrielle digne de ce nom (à rebours du Japon ou de la Chine ou de l’Allemagne), les décisions prises par le politique impactent grandement les développements industriels du pays. La question énergétique est ce constat poussé à la caricature. Il n’en reste pas moins que l’on assiste depuis des années à une accumulation de décisions aberrantes sur des dossiers mal instruits qui incite à se demander comment les décisions sont prises. La réponse est en fait assez simple, elle est liée à notre régime de « monarchie présidentielle » qui se décline à tous les étages de l’exécutif.
A la tête de l’exécutif, depuis des années, des ministres, des présidents qui n’ont qu’une connaissance livresque de ce qu’est l’industrie. Pour eux, les usines sont des lieux où l’on organise des cérémonies d’inauguration. Ils n’ont qu’une vague idée de ce que signifie « compétence », « formation », « savoir-faire », « outil industriel ». Les préoccupations de ces dirigeants n’ont à peu près rien à voir avec le monde industriel, et tout à partager avec le monde des financiers, c’est-à-dire l’immatériel et le furtif. Il en résulte que toute industrie est perçue comme un avatar des développements d’appli pour les i-phones (d’où la « start-up nation »), ou comme une ligne dans un tableur Excel (d’où les ventes à la découpe plus ou moins heureuses). L’exécutif ne sait pas ce qu’est l’industrie, il ne s’y intéresse pas, il n’y voit souvent que des variables d’ajustement dans des stratégies électorales. Quoique nous ayons atteint ces dernières années des sommets dans la perte du sens du bien commun, du sens de l’état, et du sens tout court, il faut autre chose pour que le risque se mue en désastre. Cet autre rouage de la machine infernale est la cour de « conseillers » qui entourent le prince et dans cette cour, les polytechniciens jouent un rôle important.
Je ne parle pas des « cabinets de conseil » auxquels on fait abondamment appel pour dire ce qu’on a envie d’entendre et qui distillent une prose presque exempte de tout contenu technique. L’omniprésence de ces officines, et le coût de leurs services, révèle à la fois la nature de l’attente des gouvernants, et l’absence quasi-totale de sens critique pour les questions techniques.
Je parle des conseillers censés instruire les dossiers pour les ministres. Il fut un temps où ils avaient des compétences, non pas toutes les compétences, mais celle essentielle de savoir ce qu’ils ne savaient pas, de comprendre ce qui était important, et de se mettre en état de questionner intelligemment des experts. Pour avoir cette capacité, il faut avoir été confronté à la réalité des choses, ce qui n’est pas le cas quand on sort de l’École. La plupart des conseillers ministériels ont l’élégance de la jeunesse, comme les courtisans de Louis XIV avaient celle des rubans et dentelles. Mais trop fréquemment on trouve des disciples de Rivarol qui disait justement que « c’est un grand avantage de n’avoir jamais rien fait, mais qu’il ne faut pas en abuser ».
On pourrait imaginer un système de mentorat ou un « conseiller » plus senior puisse former les nouveaux arrivés. On pourrait rêver que les corps constitués, au lieu d’être des syndicats gardiens de domaines réservés, comprennent comme une de leurs missions essentielles cette formation des nouveaux entrants. On pourrait imaginer qu’un jeune polytechnicien ne rejoigne un cabinet ministériel comme conseil qu’après avoir pratiqué dans le domaine qu’il est censé couvrir. L’obsession du potentiel conflit d’intérêt que pourrait présenter un appel à la compétence exercée en dehors de la fonction publique fait songer à la boutade de Oscar Wilde qui disait « ne jamais lire un livre dont on lui demandait la recension, de crainte d’être influencé ! » .On pourrait même espérer que, conscient des limites de la formation excellente qu’il a reçu, un jeune polytechnicien refuse de conseiller dans un domaine où il ne connaît rien, et qu’il accepte de le faire plus loin dans sa carrière en paiement de sa dette à l’état. Il n’en est rien. Depuis une dizaine d’années, l’évolution des cabinets ministériels est très exactement le contraire de ce qu’on serait en droit d’attendre si on voulait véritablement une expertise guidant la décision : on voit une décroissance marquée des compétences scientifiques et une diminution prononcée de la durée en poste. Le poste de conseiller dans un ministère est un chemin vers d’autre postes, où l’on valorise au moins autant son carnet d’adresse que son profil de compétences. Pour le dire tout net, les conseillers ne font que passer, et souvent préparent leur poste suivant, et n’instruisent pas les dossiers techniques faute de compétence pour le faire, ou de courage pour dire à « leur » ministre autre chose que ce qu’il a envie d’entendre.
Cette peur panique de déplaire à une autre conséquence : non seulement ils ne font pas leur travail qui serait d’instruire avec rigueur les dossiers techniques, mais ils font tout pour que cela ne soit pas fait. Par exemple, j’ai demandé en vain la réunion du « comité à l’énergie atomique », prévu par la loi, comité qui doit être présidé par le premier ministre, et tous les conseillers des cabinets s’opposaient à sa tenue, probablement tétanisés de crainte que viennent sur la table, portés par des gens connaissant le dossier, des questions dont ils ne souhaitaient pas parler devant tel ou tel ministre. Pas de recension des rapports transmis par l’académie des sciences, par l’académie des technologies. Pour ne rien dire des rapports que j’ai dirigés comme Haut-Commissaire à l’énergie atomique, partis pour caler je ne sais quelles armoires! Il résulte de cela que les dossiers techniques ne sont pas instruits parce que ceux qui sont censés le faire manquent soit de compétence pour le faire, soit de courage pour faire passer l’intérêt de l’État avant leur plan de carrière.
C’est cette double absence, amplifiée par les relations endogames entre la haute administration et l’industrie, qui est la source de nos maux. C’est parce que l’exécutif se moque du contenu tant qu’il ne se heurte pas à la dure réalité des faits, et que tant de « conseillers » ne font pas le travail de conseil qui est le leur, que la « machine infernale » peut tourner à plein régime avec les conséquences délétères que l’on voit aujourd’hui.
J’aime à penser que votre génération, face aux désastres qui se profilent, du point de vue climatique, économique, industriel, social, aura à cœur de fournir à l’état des serviteurs dignes des Georges Besse et des Louis Armand. Des conseillers « comestibles » en lieux et place de conseillers « toxiques ». Si plus tard dans votre carrière vous avez-vous-même à recruter des conseillers, voici quelques règles vous permettant d’éviter les toxiques. Un conseiller toxique se caractérise par les observations suivantes :
• Dans un monde techniquement illettré, il se pare d’un titre supposant une compétence qu’il n’a jamais pratiqué
• Il a un avis sur tout, tranché et sans nuance, de préférence sur les sujets qu’il ne connaît pas de première main…
• Il ne cherche jamais à approfondir les avis qu’on lui transmet, à poser des questions pour comprendre
• Il émarge à la catégorie « Gloutons d’idées » qui, selon le philosophe Alain, sautent sur toute idée séduisante, avalent l’hameçon, la ligne et la canne à pêche, et se dédouanent de toute responsabilité en arguant du droit à l’erreur.
• Il ne transmet à son maître que les informations qui le confortent dans ses convictions et il fait écran à tout contact avec le maître qui ne passerait pas par lui, et qui pourrait apporter une lueur qui ne soit pas filtrée par lui.
Nécessité fait loi. L’État aura toujours besoin de conseillers pour instruire pour l’exécutif les dossiers techniques. Les polytechniciens peuvent et doivent contribuer au « devoir de conseil » rendu indispensable par la technicité du monde qui nous entoure et la complexité des systèmes à considérer. L’état du pays ne lui permet plus de tolérer des courtisans qui, pour reprendre le mot cruel de Jonathan Swift, « rampent dans la position même où l’on grimpe ». Il y a urgence : effondrement de notre industrie , destruction de notre souveraineté industrielle, illusion complète voire entretenue sur l’étendue du désastre, crises climatiques majeures à venir…retrouver le sens du devoir n’est plus une option, c’est une question de survie…et pour reprendre le mot d’un ancien ( pas si loin de votre génération), pas encore antique ( pas tout à fait de la mienne), Vincent Le Biez, qui, passé par cette école et le corps des Mines, est devenu de ces grands serviteurs de l’État qu’on voudrait croiser plus souvent « nous avons besoin de vos solutions, pas de vos états d’âme ». Les jeunes polytechniciens ont un rôle à jouer, un rôle essentiel, pour peu qu’ils aient le courage de faire passer leur sens du devoir avant leur goût du pouvoir, et ce qu’ils doivent à leur pays avant la carrière qu’ils pensent leur être due.
En conclusion, après avoir placé ce discours sous le parrainage de quelques grands anciens, je voudrais revenir à un autre grand homme de notre Pays, Vauban, l’ingénieur militaire de Louis XIV, l’homme qui osa, après avoir passé sa vie à fortifier le royaume, écrire la « Dime royale » sur les injustices fiscales de l’ancien régime, ce qui lui valut sa disgrâce. A ceux d’entre vous qui choisiront de servir l’état pour payer votre dette, Vauban sera de bon conseil et la lecture de sa correspondance est une mine de réflexions profondes. Dans son « Eloge de Vauban , Fontenelle écrit « Nullement courtisan , il aurait infiniment mieux aimé servir que plaire ». Lucide, Vauban écrit à Le Pelletier en 1695, « La plupart des gens répètent comme des perroquets ce qu’ils ont entendu dire à des demi-savants qui, n’ayant que des connaissances imparfaites, raisonnent le plus souvent de travers ».
Mais la leçon ultime de Vauban, et de tous ces grands serviteurs de l’état dont je vous ai entretenu, est que l’on conseille le prince mais que c’est l’État que l’on sert. Quand on confond les deux, et que l’on sert le prince, on ne mérite plus que le titre de courtisan qui est juste en dessous de celui de laquais. Et si vous devez aller au service de l’État dans les temps difficiles qui se profilent, souvenez-vous que le verbe « servir » ne doit pas se conjuguer sous la forme pronominale « je me sers », mais sous sa forme transitive « je sers ».
Je vous remercie de votre attention.