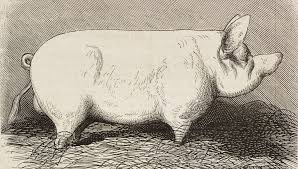A Sainte Soline, S. est stabilisé. On se sait pas encore s’il s’en sortira (on prie pour), il est toujours dans le coma, mais déjà il n’est pas mort. Ses parents ont communiqué : « nous sommes fiers et nous portons plainte ». Autrement dit : nous sommes debout ! M., lui, ne risque plus la mort. Un autre a perdu son œil, un ou une autre risque de le perdre. Un ou autre autre son pied. Des dizaines de blessés. Des centaines personnes traumatisées. Et les secours empêchés de venir. Et la préfecture qui ment.
A Paris, les arrestations arbitraires, les matraquages sauvages, les descentes dans des bars queer précédées de saluts nazis. A Nantes, les agressions sexuelles en commissariat. A Paris, Darmanin qui défend les flics. A Rouen, un pouce arraché. Ailleurs, un œil perdu par un cheminot. Ailleurs, 18 agrafes dans la tête d’un autre. Partout : les nasses, les reconductions au métro par des brutes armées, la peur de l’arrestation, la peur pour les amies en garde à vue, la peur de ceux qui ne donnent pas de nouvelles après 22h : sont-ils aux urgences ou au commissariat ? Quelque part, Tino, 13 ans, se prend une grenade à 1 centimètre de l’œil. Partout, l’inquiétude pour les amis grévistes, les camarades réquisitionnés. Sur les ondes : l’alternance la plus dégueulasse entre mensonge et servilité.
Alors, après les Gilets Jaunes, après les retraites 2019, après tout ça, il vient un moment où il faut chercher un mot pour décrire la force qui nous opprime. Police ? Milice ? Brutes ? On s’y perd en considérations institutionnelles et langagières. Mais là, l’histoire et la symbolique nous aident en nous donnant l’allemand :
Schutzstaffel
En français, « escadron de protection ».
Protection de quoi ?
D’abord : du chef. Espèce de milice minable peuplée d’abrutis fanatisés, leur rôle était de protéger les dignitaires. Que font une quinzaine de camions de CRS à « Savines-Le-Lac » (1100 habitants), sinon protéger Macron ? Que font ceux qui poursuivent une dame ayant écrit « ordure » sur son fil Facebook en parlant de Macron sinon protéger le chef ? Que faisaient ceux que protégeaient l’Élysée en 2018 ? Ils se sont (et nous ont) raconté qu’ils protégeaient les institutions (lesquelles sinon celles du chef ?), mais ils ne protégeaient que le chef. Escadron de protection donc. Schutzstaffel.
Ensuite, d’autre chose : d’elle même. A mesure de sa montée en puissance, la Schutzstaffel s’est autonomisée, politisée. Elle a récupéré du pouvoir, des moyens. Parallèle à faire avec les syndicats de police manifestant devant l’assemblée nationale, disant ouvertement que « l’ennemi de la police, c’est la justice », que la constitution est un problème, etc. Syndicats qui n’ont qu’à lever le petit doigt pour que leur régime spécial soit sauvé. En 2019 comme en 2023. Syndicats qui réclament des milliards et les ont dans l’heure. Demanderaient-ils 100% d’augmentation qu’ils l’auraient dans la journée. Qu’elles sont belles les voitures des flics quand les universités tombent en ruine ! Qu’ils sont beaux ces blindés Centaure quand les hôpitaux entassent les patients sur des brancards ! Et on rappelle que la France compte plus de flic par habitant que la RDA des années 60 ! Mais il en faut encore plus ! Qu’on les recrute à 4 au concours, si 6 ne suffit plus. Ça fera plus de brutes serviles dans la Schutzstaffel.
Enfin, d’encore autre chose.
L’ami Frédéric Lordon, dans son dernier blog, parle d’affrontement. Dieu! qu’il a raison. Comme toujours. Car en ce moment c’est là que nous en sommes : l’affrontement entre « les civilisés de la barbarie et les barbares de la civilisation ». Et cet affrontement ne fait que (re)commencer, cette fois avec des contraintes physiques qui le rendent mortel pour tous si les mauvais gagnent.
Aujourd’hui, il se joue d’abord sur la question des retraites, qui fédère l’opinion. Mais il en va de la santé, de la vie, de l’ensemble du corps social (mais surtout de la classe ouvrière), condamné par le chef à servir deux ans de plus simplement parce que le chef veut montrer qu’il en a une grosse. La classe ouvrière, puis les étudiants, puis tout un tas de gens, ont très vite compris et développé qu’il ne s’agissait pas que de ça mais qu’en fait le c’était le vase tout entier qui était en train de tomber de la table. Il en va des hôpitaux, des étudiants, du travail en général, du climat, des bassines, de l’écosystème, et l’école, de TOUT en fait.
Et que fait leur schutzstaffel ? Réprimer, indifféremment. Protéger le chef. Pousser ses intérêts propres.
Que fait le chef ? Se cacher, faire réprimer, cracher sur ceux qui ne sont rien (tous).
Il y a quatre ans, j’écrivais un blog à propos de la précédente réforme des retraites. J’avais déjà peur que face à la surdité du pouvoir, la tentation de l’action directe devienne plus qu’un délire de fin de soirée. Nous y allons tout droit.
La question climatique, celle de l’écosystème, ce ne sont pas des questions politiques comme les autres. Il s’agit des conditions de vie de mes enfants. Des vôtres. Des leurs. Je ne veux pas vieillir et mourir sans me dire que j’aurai tout fait pour leur éviter ce que le capital pétrolier leur prépare: un fascisme à +5 degrés. Je veux pouvoir les regarder en leur disant que j’ai essayé. Idéalement être fier d’avoir gagné. DONC, j’agis. A ma mesure. En écrivant, en militant, en manifestant, en donnant de l’argent, en allant sur des piquets comme au Havre ou Ivry.
Certains, comme à Sainte-Soline, agissent dans des proportions supérieures. D’autres ailleurs encore.
Mais quand la schutzstaffel leur réserve ce traitement, quelle option reste-t-il ? Quand elle massacre des étudiants, des syndicalistes, des passants, des touristes, des mineurs ? Quand le pouvoir affiche une telle violence, un tel mépris pour celles et ceux qui luttent pour leurs gamins, pour les gamins qui luttent pour eux et les leurs, pour tous les gens qui luttent pour la vie, que reste-t-il ?
Il ne reste que l’action directe. Nul doute qu’elle viendra, et vite. « Vengeance pour S. », ai-je lu sur un mur lors de la manifestation du 28 mars. Il faut dire qu’en l’absence de justice (trop occupée à mettre -macronordure- en prison), il ne reste que la vengeance. Face à tout ça, des gens vont basculer dans la clandestinité et passer à l’action violente. La vraie. Sabotages et pannes devraient venir vite. A titre personnel, si je n’avais pas mes enfants pour m’en empêcher, la tentation serait grande. Des néo brigades rouges.
Mais l’affrontement implique deux camps, celui de la vie (nous) et celui de la mort : le capital, ses intérêts et sa schutzstaffel. Des brigades brunes risquent bien de voir le jour. A vrai dire elles existent déjà, elles. Et elles tuent. Le pouvoir va s’enfermer dans la radicalité et la répression. Il en dépendra toujours plus de sa schutzstaffel qui ne manquera pas d’en tirer toujours plus d’avantages financiers et politiques. Il dépendra des milices secondaires en leur laissant passer quelques « errements ». C’est exactement ce qu’il s’est déjà passé. (la schutzstaffel était bien vue de la police de Weimar, ils s’habillaient bien). C’est exactement ce qui est déjà en train de se passer.
Au milieu de tout cela, d’un peuple majoritairement révolutionnaire, de bandes armées officielles ou non réprimant les militants, la bourgeoise centriste ne pourra que glisser vers le pire. Elle ne sait faire que ça. Son tas de fric est si important. Sa place sociale si méritée. Ces ouvriers si vulgaires. Comme celle des damnés, elle finira nazie.
Mais peut être, si nous sommes assez forts, si nous savons nous organiser, nous fédérer, et vaincre, finira-t-elle seulement dans les poubelles. Peut être que la schutzstaffel finira au GOULAG avec le chef. Peut être que le travail sera libéré. La vie sauvée. Nos enfants fiers de nous. Il suffit pour cela de nous donner corps et âme aux soulèvements, aux grévistes, à tous ceux qui montrent le chemin aux timides et se tiennent debout !