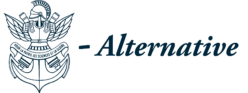L’attaque des titans (Shingeki no Kyojin ou SNK pour les initiés), est un manga de type shonen extrêmement populaire, tant dans sa version écrite que télévisuelle animée. Le manga s’est vendu à 140 millions d’exemplaires papier et la série a connu une immense popularité au moment du confinement en Europe et aux États-Unis.
L’univers de l’œuvre, pouvant paraître rebutant pour les adultes, constitué d’une humanité assiégée par des monstres anthropomorphes n’ayant pour seul but que dévorer les humains, est pourtant profond et éminemment politique. Souvent les critiques appuient sur cet axe. Il faut dire que les références sont nombreuses et évidentes : étoiles jaunes, champignons atomiques, militarisme, tranchées, élites cachant la vérité aux masses.
On est, au premier chef, tentés de lire la série ainsi : une critique politique d’un moment actuel (confinement, Israël, Gaza, Ukraine, …) ou passé (14-18, Hiroshima, Shoah, colonialisme, …). Et c’est ainsi que la chose a souvent été lue. Mais au fil des épisodes et du déroulement du scénario, quelque chose apparaît : on se prend dans les méandres de la politique, dans les affres de la guerre, mais surtout on se lie aux personnages auxquels on peut quasiment tous s’identifier, qu’il s’agisse d’un enfant, d’une mère, d’un vieux général. Il faut dire qu’on découvre les choses à leur rythme et qu’à leur manière, on passe d’enfant à guerrier, nourri de la même haine et du même désespoir face à l’absurde des titans.
A l’opposé d’un « Game Of Thrones », où seule compte la politique et où les personnages n’ont d’autre intérêt que d’en être des protagonistes plus ou moins répugnants, ici c’est le contraire : la politique est une trame tragique dans laquelle évoluent des êtres humains. Dans SNK, plus la politique (la tragégie) avance, plus on va de bouleversement en drame, moins la politique compte et plus on se pose la question importante : pourquoi personne n’est amoureux de personne ?
Certes nous sommes entraînés à voir ailleurs cette froideur mais ici c’est très choquant : les gens meurent, souffrent, sont déplacés, déportés, assassinés, vivent le pire ensemble mais jamais autre chose que de l’amitié très timide.
On pourrait mettre ça sur le dos bien large de la culture manga, voire sur celui de la culture japonaise, mais en réalité il en va d’autre chose : les gens sont déterminés par la structure des choses.
Dès la première scène on peut déjà lire la fin : Eren, enfant, rêve déjà d’un futur qu’il n’aura pas d’autre choix que de vivre.
Ainsi, SNK est une guerre de Troie : la guerre (enfin ses modalités) n’importe pas. Il fallait qu’elle ait lieu et elle aura toujours lieu. Que les Mahr manipulent les titans à leur guise, que Paradis soit un enfer de mensonge, peu importe. Ce qui compte, ce sont les gens plongés dans la guerre, peu importe comment ils la comprennent ou la vivent : elle est là et les détermine. En tant qu’enfants comme les principaux protagonistes au début. En tant qu’esclave comme Ymir (la mère des titans) 2000 ans avant les faits. En tant que dieu omnipotent, comme un des personnages à la fin. Ou en tant que simple survivant, plus ou moins courageux, comme tous les autres.
Ainsi la trame réelle est l’amour : omniprésent mais incapable de se déployer, comme réprimé. Entre amis d’enfance, d’esclave à roi, entre officiers dans l’armée, entre geôlière et prisonnier, entre vainqueur et vaincue.
Pris dans la politique en tant qu’acteur-spectateur, pris dans la cruauté de la guerre, nous oublions, peut-être à dessein, ce qui lie les personnages entre eux à l’échelle individuelle : l’amitié, le respect, la loyauté, l’amour.
A la toute fin de la série, ceci explose et ce qui était un sentiment latent devient une évidence : les personnages ont, bien malgré eux, autre chose à faire que l’important dans leur cœur. Comme le dit Armin : « nous n’avons même pas essayé de parler ». Mais en réalité, ils ne peuvent pas. Ils sont dévorés par la vengeance, par la haine, par la curiosité, par l’autorité, sans jamais laisser le temps à ce qui compte le plus : aimer celui ou celle qui compte, et lui dire. Eren et Mikasa sont évidemment éperdument amoureux l’un de l’autre mais, comme le voit Eren, leur amour est impossible dans ces structures.
« L’amour qui meut le soleil et les étoiles du ciel » (Dante, La Divine Comédie XXXII-145) meut certes le soleil, les étoiles, les corps et les cœurs mais il ne peut pas grand-chose à l’échelle des sociétés humaines, elles déplacées par des forces bien plus sordides, qui emprisonnent ses membres dans un enfer dont ils ne peuvent sortir individuellement, auraient-ils l’impression d’y faire des choix, comme celui de se battre ou de fuir.
Comment, dans ces conditions, ne pas reconnaître que SNK décrit précisément l’important dans la guerre : l’éradication de l’humanité (telle que représentée à la fin) ? Il ne s’agit pas de savoir qui a le plus de chars, qui a le plus de morts ni qui gagne à la fin : ce qui compte c’est que tous y perdent leur cœur, ou presque.
Les personnages de SNK, comme nous, subissent cette malédiction sociale. Toute provoquée qu’elle soit par des intérêts ou des vengeances, la guerre de Troie, la guerre éternelle, dévore leurs âmes. Comme les titans dévorent les hommes, comme les bombes pleuvent sur des enfants : sans raison.