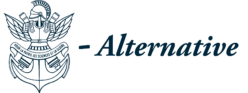« L’École polytechnique est ainsi la seule Grande École française dont les élèves, appelés à prendre une part essentielle dans la défense – entendue au sens large – et le développement des intérêts du pays, sont confrontés au monde militaire et aux défis géostratégiques. École militaire, elle développe et diffuse des valeurs essentielles d’engagement, de don de soi et de sens de l’intérêt général », peut-on lire sur le site public de l’École polytechnique en guise de présentation. Et pourtant, à voir les parcours choisis par une grande partie de ses étudiant⋅es à leur sortie, on peut légitimement se demander ce qui différencie l’X de n’importe quelle autre école d’ingénieurs. Certes, une partie des X rejoignent un corps, mais les places restent chères et la majorité choisit la voie du privé, et en particulier du privé lucratif, dont le sens de l’intérêt général reste discutable. Il n’est d’ailleurs pas surprenant qu’en pleine crise climatique et sociale, qui repose la question des conditions existentielles de notre humanité, de plus en plus d’X ne trouvent plus de sens à leur parcours et cherchent des alternatives. Le retour de la pantoufle – ou « engagement décennal » – offre une opportunité idéale pour refaire de l’X une école réellement au service de la Nation.
En effet, nombreux⋅ses sont celles et ceux qui font face à un désalignement entre leurs valeurs personnelles et leur quotidien professionnel, se rendant bien compte que le fruit de leur travail sert davantage à faire croître le capital – celui de l’entreprise, des actionnaires ou le leur – qu’à résoudre efficacement des problèmes de société (quand il ne les aggrave pas). Certain⋅es font alors le choix du secteur public qui apparaît comme la principale alternative. Pourtant, il existe au sein du secteur privé des structures guidées par l’intérêt commun : c’est le cas de l’Économie Sociale et Solidaire (ESS). Toutefois ce secteur de l’économie reste encore peu investi par nos camarades, probablement pour des questions de rémunération mais certainement aussi par simple méconnaissance. L’ESS est en effet un levier formidable de transformation de l’économie, car elle requestionne le principe même de la lucrativité des entreprises, tout en conservant celui de la rentabilité ; elle instaure des règles de gestion saines et transparentes, comme la limitation des écarts maximaux de salaires au sein de la structure ; et elle propose des modèles de gouvernance démocratique où chaque salarié·e, et parfois même chaque partie prenante (fournisseur ou client), retrouve une réelle souveraineté. C’est notamment le cas des coopératives, qui sont des sociétés de personnes et non de capitaux, et plus encore des SCIC – Sociétés Coopératives d’Intérêt Collectif – qui donnent une voix aux différentes parties prenantes du projet.
Par ailleurs, et contrairement aux idées reçues, l’ESS n’est pas un secteur de l’économie « sous perfusion », c’est même le contraire ! Un rapport de la Cour des Comptes sur les soutiens publics à l’ESS, sorti en septembre 2025, le démontre : ce secteur, qui représente 13,7 % de l’emploi privé en France, reçoit au total 7 % des aides de l’État aux entreprises, soit moitié moins en proportion que le reste de l’économie conventionnelle. À cela s’ajoute le fait que les contreparties et contraintes réglementaires associées à ces aides publiques sont beaucoup moins exigeantes – quand elles ne sont pas inexistantes – pour les entreprises lucratives que pour les entreprises de l’ESS. Pourtant, ESS France souligne que « […] l’étude de la Cour des Comptes met en évidence le rôle considérable joué par l’ESS dans la mise en œuvre des politiques publiques. La Cour démontre notamment que 80 % des subventions touchées par l’ESS sont des dépenses pour garantir des droits ou assurer des services dans le prolongement de l’action de l’État, prouvant que l’ESS est une économie indissociable de l’intérêt général ». Enfin, les entreprises de l’ESS, et en particulier les coopératives, sont globalement plus résilientes que les entreprises classiques. En 2024 en effet, le taux de pérennité à 5 ans était de 79 % pour les coopératives – société coopérative de production (SCOP) et SCIC – contre 61 % pour l’ensemble des entreprises françaises. Cette stabilité peut en partie s’expliquer par ses réserves, impartageables et définitives, et probablement aussi par une implication de ses sociétaires et salarié⋅es beaucoup plus forte que dans les sociétés traditionnelles.
Le retour de l’engagement décennal offre une superbe opportunité pour investir et développer ce secteur de l’économie. Cet engagement prévoit en effet que « […] tous les élèves français ayant terminé leur scolarité sont tenus à une obligation de servir 10 ans dans un corps de l’État ou auprès d’une entité du « secteur public » (ministère, administration publique, établissement public…). » Dans le cas des élèves non-corpsard⋅es, le document d’information fourni aux élèves précise plus loin que l’obligation peut également être remplie dans toute « […] entreprise ou organisme privé d’intérêt général ou de caractère associatif assurant des missions d’intérêt général » (en vertu de l’article 14 du décret du 16 septembre 1985). L’engagement décennal prévoit donc la possibilité de remplir son obligation en travaillant pour une structure privée à condition qu’elle soit d’intérêt général. Cette précision offre un élargissement potentiel considérable pour tous les X qui n’auraient pas la possibilité de rejoindre un corps ou qui ne souhaiteraient pas rejoindre la fonction publique. Je suis par ailleurs persuadé qu’un tel mouvement de la part de nos « élites » vers le privé d’intérêt général aurait un effet décisif sur la transformation de notre économie, avec un effet d’entraînement très fort sur le reste des jeunes diplômé⋅es de grandes écoles.
Reste cependant à clarifier ce que l’administration entend par « intérêt général » pour que ce re-routage des X en fin de cursus puisse être effectif. La circulaire DGAFP n° 2165 du 25 juin 2008 précise certains critères cumulatifs indispensables pour l’attribution du caractère « d’intérêt général » à une personne privée :
- Les structures privées doivent contribuer à des actions qui sont rattachables à une politique publique dont la responsabilité incombe à 1’État ou à une autre collectivité publique, en complément ou dans le prolongement des actions conduites directement par la puissance publique ;
- Doivent être par ailleurs être pris en considération : le fonctionnement démocratique de l’organisme, sa transparence financière, son respect de l’ordre public, la qualité de son service ;
-
L’intérêt général ne se confond pas avec l’intérêt de la personne privée qui exerce l’activité en cause.
Cette notion, encore mal définie aujourd’hui dans le droit français, repose en grande partie sur la jurisprudence du Conseil d’État et son appréciation est faite au cas par cas. Ainsi, des critères alternatifs ont pu être retenus, comme la forte implantation territoriale de l’entité ou le caractère non lucratif de l’activité.
Pour un certain nombre de structures de l’ESS toutefois, l’attribution du caractère d’intérêt général semble assez indiscutable. C’est par exemple le cas de l’opérateur de télécommunications coopératif Telecoop, de la NEF (coopérative de finance solidaire) ou encore d’Enercoop. Cette dernière est une coopérative (de type SCIC) de fourniture d’électricité 100 % renouvelable que je connais bien puisque j’en suis salarié et sociétaire depuis plus de quatre ans. Son activité de production et de fourniture est bien d’intérêt collectif présentant un caractère d’utilité sociale. De plus, Enercoop présente un fonctionnement démocratique (1 personne = 1 voix), sa gouvernance ainsi que son actionnariat font intervenir la puissance publique (présence de collectivités territoriales par le biais de participation au capital social), sa lucrativité est limitée et son projet d’utilité sociale a obtenu un agrément préfectoral. Pour d’autres structures de l’ESS, l’attribution du caractère « d’intérêt général » est moins évidente. Je pense notamment à certaines coopératives de commerçants dont les intérêts de la structure peuvent parfois prendre le pas sur l’intérêt général.
Il apparaît dès lors de première importance de détailler plus spécifiquement le cas du remplissage de l’engagement décennal au sein de l’ESS et de sécuriser cette notion d’intérêt général en s’appuyant sur la jurisprudence établie en cas de litige. En effet, la validation par l’École du respect de l’engagement décennal – via l’analyse de l’état récapitulatif des services – n’intervient pas avant les 5 années qui suivent la sortie de l’X. Et l’appréciation du caractère « d’intérêt général » au sein de l’École revient au bout du compte au président ou à la présidente du conseil d’administration de l’École, soit dit en passant nommé·e par le gouvernement… Il serait dommageable (et par voie de conséquence très dissuasif) de pénaliser des alumnis parti⋅es travailler dans des structures de l’ESS, dont le critère d’intérêt général se trouverait finalement rejeté par l’administration a posteriori et qui exigerait de leur part un remboursement de la pantoufle.
Cependant, tout cet effort juridique et administratif restera vain si l’École polytechnique ne participe pas par ailleurs à visibiliser ce secteur de l’économie complètement sous-investi et méconnu des X, élèves comme diplômé⋅es. Le moment est d’ailleurs opportun puisqu’en novembre 2025, la France est censée publier sa stratégie nationale de l’ESS à horizon 2035 [NDLR : publication finalement repoussée à mars 2026], faisant suite à une grande consultation de l’État sur le sujet. L’X pourrait pleinement s’inscrire dans cette stratégie nationale grâce à son vivier d’étudiant⋅es disposé⋅es à servir la Nation. Et si cela ne suffisait pas, les Nations Unies ont décrété l’année 2025 « Année des coopératives ». Encore un signal, s’il en fallait un, de l’importance de remettre l’intérêt général au cœur de la mission de l’École polytechnique.